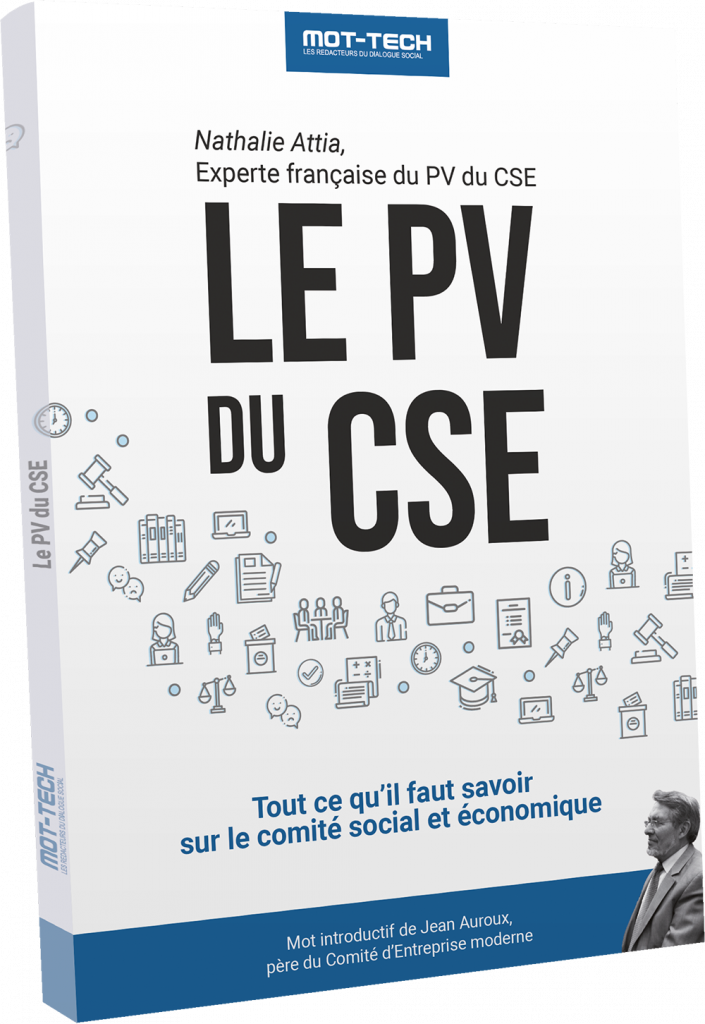La composition du comité social et économique (CSE) est strictement encadrée par le Code du travail. Cette instance, qui remplace depuis 2020 les anciens comités d’entreprise, délégués du personnel et CHSCT, rassemble employeur, représentants du personnel et délégués syndicaux selon des règles précises.
Les trois composantes principales du CSE
L’employeur et ses collaborateurs
L’employeur préside obligatoirement le CSE ou délègue cette présidence à un représentant disposant des pouvoirs nécessaires. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, il peut être assisté de trois collaborateurs maximum, tous salariés de l’entreprise. Ces collaborateurs disposent d’une voix consultative : ils participent aux débats mais ne votent pas.
Pour les entreprises de moins de 50 salariés, l’employeur peut également s’entourer de collaborateurs, mais leur nombre ne peut dépasser celui des représentants du personnel titulaires. Cette règle garantit l’équilibre des forces au sein du CSE.
La délégation du personnel élue
La délégation du personnel constitue le cœur démocratique du CSE. Elle comprend un nombre égal de titulaires et de suppléants, élus par les salariés pour quatre ans (durée modifiable par accord collectif entre 2 et 4 ans). Les suppléants assistent aux réunions uniquement en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Un membre ne peut exercer plus de trois mandats successifs au sein d’un même CSE, sauf dans les entreprises de moins de 50 salariés ou en cas d’accord collectif dérogatoire. Cette limitation favorise le renouvellement démocratique.
Les représentants syndicaux
Les représentants syndicaux participent au CSE avec voix consultative. Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est automatiquement représentant syndical au CSE. Au-delà de 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant distinct du délégué syndical.
Un salarié ne peut pas siéger simultanément comme membre élu et représentant syndical au même CSE. Les organisations syndicales doivent informer l’employeur et l’inspecteur du travail de leurs désignations.
Le bureau du CSE : secrétaire et trésorier
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE doit obligatoirement désigner un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.
Le secrétaire du CSE
Le secrétaire joue un rôle central dans le fonctionnement du CSE. Élu à la majorité des membres titulaires présents (l’employeur peut participer au vote), il assure plusieurs missions essentielles :
- Établissement de l’ordre du jour conjointement avec l’employeur : définition des points à traiter, priorisation des sujets selon leur urgence, intégration des demandes des membres du CSE et des questions transmises par les salariés
- Rédaction et diffusion des procès-verbaux : transcription fidèle des débats, synthèse des décisions prises, mention des votes et positions de chacun, transmission dans les délais légaux aux membres et affichage obligatoire
- Gestion des affaires courantes : traitement du courrier du CSE, suivi des dossiers en cours, préparation des dossiers techniques, coordination avec les experts externes le cas échéant, interface privilégiée avec l’employeur
- Conservation des archives : classement et archivage de tous les documents du CSE (ordres du jour, procès-verbaux, rapports d’expertise, correspondances), garantie de leur accessibilité et de leur traçabilité
Sa présence aux réunions est impérative. En cas d’absence, un remplacement immédiat doit être organisé.
Le trésorier du CSE
Le trésorier gère la dimension financière du CSE, particulièrement importante pour les budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles. Ses responsabilités incluent :
- Gestion des comptes bancaires du CSE : ouverture des comptes, choix des établissements bancaires, suivi des mouvements de trésorerie, réconciliations bancaires mensuelles et relations avec les banques
- Tenue de la comptabilité et des écritures comptables : enregistrement chronologique de toutes les opérations, classement des pièces justificatives, suivi des budgets alloués, contrôle des dépenses et recettes
- Préparation du compte rendu annuel de gestion : établissement du bilan financier annuel, analyse des écarts budgétaires, présentation des comptes aux membres du CSE et transmission à l’employeur dans les délais requis
- Administration des salariés du CSE le cas échéant : gestion de la paie, déclarations sociales, contrats de travail et suivi administratif du personnel éventuellement employé par le comité
Toute décision d’engagement budgétaire nécessite une délibération préalable du CSE.
Nombre de représentants selon l’effectif de l’entreprise
Le nombre de représentants du personnel varie selon l’effectif de l’entreprise, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois.
Entreprises de 11 à 199 salariés
- 11 à 24 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant (10 heures de délégation/mois)
- 25 à 49 salariés : 2 titulaires et 2 suppléants (20 heures de délégation/mois)
- 50 à 74 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants (72 heures de délégation/mois)
- 75 à 99 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants (95 heures de délégation/mois)
- 100 à 149 salariés : 6 à 7 titulaires et autant de suppléants
- 150 à 199 salariés : 8 à 9 titulaires et autant de suppléants
Entreprises de 200 salariés et plus
Pour les entreprises dépassant 200 salariés, le nombre de représentants continue d’augmenter progressivement, pouvant atteindre 35 titulaires et 35 suppléants dans les très grandes entreprises de plus de 10 000 salariés.
Un protocole d’accord préélectoral peut modifier ces nombres, à condition de respecter le volume global d’heures de délégation légalement fixé.
Le référent harcèlement : une obligation depuis 2019
Depuis le 1er janvier 2019, le CSE doit obligatoirement désigner un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, quel que soit l’effectif de l’entreprise.
Désignation et mission du référent
Ce référent est choisi parmi les membres du CSE (titulaires ou suppléants) par résolution adoptée à la majorité des membres présents. La désignation doit intervenir rapidement après la mise en place du CSE et faire l’objet d’une délibération formelle inscrite au procès-verbal.
Son mandat prend fin avec celui de membre élu du CSE. En cas de démission ou d’empêchement du référent, un nouveau référent doit être désigné dans les meilleurs délais selon la même procédure.
Obligations d’information et de formation
Les salariés doivent être informés de l’identité du référent et de ses coordonnées par tous moyens appropriés : affichage sur les panneaux d’information, communication sur l’intranet, mention dans le livret d’accueil ou diffusion par email. Cette information doit être actualisée en permanence.
Le référent peut bénéficier d’une formation spécifique sur les questions de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes, prise en charge sur le budget de formation du CSE. Cette formation lui permet d’acquérir les compétences nécessaires pour exercer efficacement sa mission.
Rôle de prévention et d’accompagnement
Cette fonction répond à l’obligation légale de prévention et constitue un interlocuteur identifié pour les victimes ou témoins d’actes de harcèlement. Le référent peut :
- Recevoir les signalements et assurer une écoute bienveillante
- Orienter les victimes vers les dispositifs d’aide appropriés
- Sensibiliser les salariés aux problématiques de harcèlement
- Proposer des actions de prévention au sein de l’entreprise
- Collaborer avec l’employeur pour améliorer les politiques de prévention
Le référent agit en coordination avec le référent harcèlement désigné par l’employeur, créant ainsi un double niveau de protection pour les salariés.
Intervenants extérieurs aux réunions CSE
Certaines personnes extérieures au CSE doivent être convoquées aux réunions, particulièrement pour les questions de santé et sécurité.
Participants obligatoires aux réunions santé-sécurité
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, participent obligatoirement aux réunions CSE portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail :
- Le médecin du travail (ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire par délégation)
- Le responsable sécurité interne ou l’agent chargé de la sécurité
- L’inspecteur du travail et un agent de la Carsat (sur invitation)
Ces intervenants disposent d’une voix consultative et apportent leur expertise technique aux débats.
Autres invitations possibles
Le CSE peut inviter toute personne externe dont la présence s’avérerait utile, sous réserve de l’accord du chef d’établissement. Cette flexibilité permet d’adapter la composition aux sujets traités.
Impact de la réforme : rationalisation de la représentation du personnel
La création du CSE a entraîné une diminution significative du nombre total de représentants du personnel par rapport aux anciennes instances. Cette réduction s’inscrit dans l’objectif de rationalisation du dialogue social voulu par les ordonnances de 2017.
Comparaison avec l’ancien système
L’ancien système comportait trois instances distinctes avec leurs propres élus :
- Comité d’entreprise : gestion des activités sociales et consultation économique
- Délégués du personnel : réclamations individuelles et collectives
- CHSCT : santé, sécurité et conditions de travail
Le CSE fusionne ces trois instances en une seule, ce qui mécaniquement réduit le nombre total d’élus.
Exemples concrets de réduction
Entreprise de 55 salariés – l’ancien système prévoyait :
- 6 membres de comité d’entreprise (3 titulaires, 3 suppléants)
- 3 membres de CHSCT
- 4 délégués du personnel (2 titulaires, 2 suppléants)
- Total : 13 représentants
Avec le CSE : seulement 8 représentants (4 titulaires et 4 suppléants).
Entreprise de 250 salariés – l’ancien système totalisait :
- 10 membres de comité d’entreprise (5 titulaires, 5 suppléants)
- 6 membres de CHSCT (3 titulaires, 3 suppléants)
- 10 délégués du personnel (5 titulaires, 5 suppléants)
- Total : 26 représentants
Avec le CSE : 20 représentants (10 titulaires et 10 suppléants).
Conséquences pratiques de cette réduction
Cette diminution du nombre d’élus peut avoir plusieurs impacts :
- Charge de travail accrue pour les élus restants qui doivent couvrir tous les domaines
- Nécessité d’une polyvalence sur des sujets économiques, sociaux et de sécurité
- Possible baisse de proximité avec les salariés due au nombre réduit d’interlocuteurs
Solutions de compensation
Cette réduction peut être compensée par plusieurs mécanismes. Un accord collectif peut permettre d’augmenter le nombre d’élus dans le respect du volume global d’heures de délégation légal. Un accord peut par exemple prévoir 6 titulaires au lieu de 4, avec une répartition différente des heures. Dans les entreprises d’au moins 300 salariés et les établissements de plus de 250 salariés, des représentants de proximité peuvent être désignés pour maintenir le lien avec les salariés. Aussi, les heures de délégation peuvent être mutualisées entre titulaires et suppléants pour une utilisation plus flexible selon les besoins.
Enjeux du dialogue social
Cette évolution reflète une approche différente du dialogue social, privilégiant l’efficacité et la simplification administrative tout en questionnant la proximité traditionnelle entre élus et salariés. Les entreprises doivent trouver un équilibre entre rationalisation et maintien d’une représentation de qualité.
Modalités de modification de la composition du CSE
La composition légale du CSE n’est pas figée et peut être adaptée selon les besoins de l’entreprise.
Possibilités d’adaptation
Un protocole d’accord préélectoral, un accord collectif ou un engagement unilatéral de l’employeur peut :
- Augmenter le nombre d’élus et/ou d’heures de délégation
- Redistribuer les heures entre un nombre différent d’élus
- Fixer des modalités spécifiques de fonctionnement
La contrainte principale réside dans le respect du volume global d’heures de délégation minimum fixé par décret selon l’effectif.
Flexibilité encadrée
Cette flexibilité permet d’adapter le CSE aux spécificités de chaque entreprise tout en maintenant un niveau minimal de représentation du personnel conforme aux exigences légales.
Durée et renouvellement des mandats au CSE
La durée des mandats des membres du CSE est encadrée par l’article L.2314-33 du Code du travail, avec des possibilités d’adaptation selon les besoins de l’entreprise.
Durée standard des mandats
La durée légale des mandats est fixée à 4 ans pour tous les membres élus du CSE. Cette période permet d’assurer une stabilité dans le fonctionnement de l’instance tout en garantissant un renouvellement démocratique régulier.
Un accord collectif peut toutefois modifier cette durée en la réduisant à 2 ou 3 ans, offrant ainsi une flexibilité d’adaptation aux spécificités de l’entreprise et aux souhaits des partenaires sociaux.
Limitation du nombre de mandats successifs
Un membre ne peut pas cumuler plus de 3 mandats successifs au sein de la délégation d’un même CSE. Cette règle vise à favoriser le renouvellement démocratique et à éviter la concentration durable du pouvoir représentatif.
Cependant, cette limitation ne s’applique pas dans deux cas spécifiques :
- Entreprises de moins de 50 salariés : aucune restriction sur le nombre de mandats
- Accord collectif dérogatoire : possibilité de prévoir des règles différentes
Synchronisation des mandats
Le mandat des représentants syndicaux au CSE, des délégués syndicaux et des représentants de proximité prend fin simultanément avec celui des membres élus au CSE. Cette synchronisation assure la cohérence temporelle de la représentation du personnel.
Cette règle facilite l’organisation des élections et évite les décalages qui pourraient perturber le fonctionnement du dialogue social dans l’entreprise.
Questions fréquentes sur la composition du CSE
Que se passe-t-il si un membre titulaire démissionne en cours de mandat ?
En cas de démission d’un membre titulaire, le suppléant de la même liste le remplace automatiquement jusqu’à la fin du mandat. Si aucun suppléant n’est disponible, des élections partielles doivent être organisées dans les deux mois, sauf si le mandat arrive à échéance dans les six mois suivants.
Un salarié en contrat à durée déterminée peut-il être élu au CSE ?
Un salarié en CDD peut être candidat et élu au CSE s’il remplit les conditions d’ancienneté (un an dans l’entreprise) et si son contrat couvre au moins la moitié de la durée du mandat. Cette règle assure une stabilité minimale dans la représentation du personnel.
Comment procéder si le CSE ne parvient pas à élire un secrétaire ?
Si aucun candidat n’obtient la majorité, un second tour de scrutin est organisé entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas d’égalité persistante, le poste revient au plus âgé des candidats, sauf disposition contraire du règlement intérieur.
Les heures de délégation peuvent-elles être mutualisées entre tous les membres ?
Les membres titulaires peuvent répartir librement leurs heures de délégation entre eux et avec les suppléants chaque mois. Cette souplesse permet d’adapter l’utilisation du crédit d’heures aux besoins réels et à la charge de travail de chacun.
Un CSE peut-il fonctionner sans trésorier dans une entreprise de 60 salariés ?
Non, la désignation d’un trésorier est obligatoire dans toutes les entreprises d’au moins 50 salariés. L’absence de trésorier constitue un dysfonctionnement grave pouvant justifier une saisine du tribunal judiciaire pour désigner un administrateur provisoire.
Conclusion
La composition du CSE obéit à des règles précises du Code du travail tout en offrant une certaine souplesse d’adaptation. L’équilibre entre employeur, représentants du personnel et délégués syndicaux garantit un dialogue social structuré. Les entreprises peuvent optimiser cette composition via des accords collectifs, dans le respect des volumes d’heures de délégation légaux. Cette architecture institutionnelle vise à concilier efficacité du dialogue social et représentativité démocratique des salariés.
👉 La tenue rigoureuse des procès-verbaux constitue un élément essentiel du bon fonctionnement du CSE. Découvrez nos services professionnels de rédaction de PV de CSE pour garantir la conformité légale et la qualité de vos comptes-rendus de réunions.